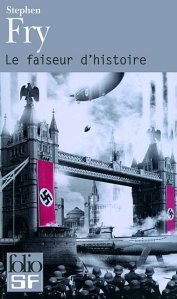Gradisil, d’Adam Roberts
29 janvier 2012 2 commentaires
 Résolument contemporain, ce roman est une anticipation à court terme, mettant en scène la colonisation des orbites les plus proches de la Terre à travers trois générations d’une famille de colons. Cela donne un roman en trois parties, une par génération.
Résolument contemporain, ce roman est une anticipation à court terme, mettant en scène la colonisation des orbites les plus proches de la Terre à travers trois générations d’une famille de colons. Cela donne un roman en trois parties, une par génération.
MacGyver et Eva Perón sont dans un avion
La première partie est contée par Klara Gyeroffy, jeune fille puis femme dont le père s’est mis en tête d’habiter en orbite basse autour de la Terre. Grâce à une technologie nouvelle (permettant à un avion d’utiliser le magnétisme terrestre pour naviguer dans l’espace depuis la haute atmosphère) ils mettent en place une petite maison, en fait une grande caisse métallique avec un sas. Trahie, Klara doit retourner sur le plancher des vaches, remontera, grandira et vieillira.
Elle aura entre temps engendré Gradisil, devenue à l’âge adulte une passionaria, militant pied à pied pour l’indépendance des Hantes-Landais par rapport aux rampants. Entre la cellule de résistance, le QG d’insurrection armée, les meetings et les voyages d’agrément avec les enfants, on voyage beaucoup en suivant les mémoires de son mari Paul Caunes. L’histoire s’écrit… Elle se termine avec le récit de son fils Hope qui donne un aperçu rapide du futur de ces gens entre ciel et terre.
Une histoire de famille éclatée
Ce livre décrit à la fois l’histoire d’une famille et la naissance d’une nation. Les deux apparaissent comme indissociables, la nation en question étant construite en bonne partie par Gradisil durant la seconde partie, de très loin la plus longue des trois. Ces deux intrigues parallèles, personnelles et politiques, donnent un intérêt à ce qui aurait été sinon une banale histoire de colonisation spatiale.
La partie familiale n’est en elle-même pas très intéressante. Les personnages, défaut d’être sympathique, sont très humains, très réalistes. On peut difficilement aimer Klara, Paul, Gradisi, Hope ou Sol, mais on les comprend. Décrits avec un luxe de détails impressionnant ils ont une texture réelle, presque photo-réaliste. Mais bien peu de choses les lient sinon quelques souvenirs communs, ce n’est pas Dallas c’est certain. Ceci dit ils servent principalement à porter un regard sur les Hautes-Landes, à fournir des exemples de « Hantes-Landais » (une horrible traduction à mon goût) au lecteur. Ils mettent en scène l’autre intrigue du livre.
Bannière à fond étoilé
La partie historico-politique vole plus haut mais serait bien froide sans ces acteurs. Souvent elle m’a rappelé Révolte sur la Lune de Heinlein, d’une certaine façon plus proche d’une vision mythifiée de la construction des États-Unis. La comparaison est de très loin en faveur de Gradisil ! Là où Heinlein pontifie, Roberts montre. On assiste au premier procès dans l’espace, on assiste aux meetings politiques, on assiste aux règlements de compte, on assiste à la guerre, tout cela à travers les yeux et les opinions des personnages principaux. Ce qui pourrait être long et laborieux en est rendu passionnant. Le lecteur voit la naissance d’une nation et sans se voir infliger toutes les étapes en connaît suffisamment pour y être pris.
Évidemment ce n’est pas à lire pour l’action ou la hard-science, les deux bien peu présentes, mais il y a du souffle et de l’ampleur dans ce gros roman. L’auteur réussit à tenir la distance, progressant comme à l’escalade piton par piton, malgré à l’occasion quelques lenteurs dans la narration qui n’entachent ceci dit ni le plaisir ni l’envie d’en savoir plus.