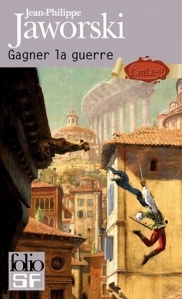Renégats, de David Gemmel
18 janvier 2012 Laisser un commentaire
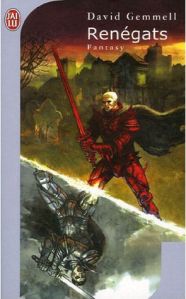 Gemmel est surtout connu pour quelques séries. Son roman Légende (et ses suites et préquelles) a été encensé, de même que ses livres sur le Lion de Macédoine. Disons qu’en achetant un de ses livres on ne prend pas de grands risques.
Gemmel est surtout connu pour quelques séries. Son roman Légende (et ses suites et préquelles) a été encensé, de même que ses livres sur le Lion de Macédoine. Disons qu’en achetant un de ses livres on ne prend pas de grands risques.
Des chevaliers, des paysans et des magiciens
Le monde est tout ce qu’il y a de plus commun en fantasy et ne brille surtout pas par son originalité. Des brigands infestent les forêts, les paysans sont dominées par la noblesse guerrière, les mages ont leur place à la cour royale ou ducale… Une petite touche de corruption qui fait tâche d’huile apparait rapidement quand les preux chevaliers vont guerroyer au loin. De nouveaux chevaliers, d’une belle couleur rouge, apparaissent. Il ne manquait plus qu’un gamin se trouve des talents de magicien ! Ah ben justement, ça arrive, seulement 3 pages après le début du chapitre 1.
Voilà au moins le résumé de la moitié du livre, qui est aussi sur la quatrième de couverture. En fait c’est à peine l’exposition car à partir du milieu du livre les personnages foisonnent, les aventures partent dans tous les sens, l’action commence en somme. Gemmel sait décrire l’action de manière très vivante, c’est indéniable, mais il n’arrive pas à rendre les tribulations de ses personnages vraiment passionnantes. Certains sont un peu plus attachants mais leur vie est tout de même très téléphonée. Quand je dis « téléphonée » j’entends « téléphonée » du style « Allo Gary ! j’écris un livre et je manque d’idées, tu pourrais m’envoyer ton dernier scénar’ plize ? Oui, le PMT¹ dans la forêt. »
Je suis méchant mais…
Il y a tout de même des choses à sauver. Tout d’abord l’univers si il n’est pas innovant est suffisamment dense pour intéresser. Sans avoir besoin de sortir des milliers de noms imprononçable Gemmel ouvre une fenêtre sur un ailleurs où l’imagination remplit aisément les trous bien disposés d’un paysage qu’il brosse à grands traits. Au milieu d’une fantasy très classique il ménage de petits détails qui le sont moins, par exemple un peuple nomade persécuté dans un royaume de châteaux et de chevaliers. Le dernier quart du livre apporte même pas mal d’idées, qui sans surprendre sont intelligemment amenées. La magie est sympathique aussi. Basée sur les couleurs, chacune associée à une émotion, elle n’est pas qu’un ensemble de formules plaquées là, elle a un sens dans l’univers et un esthétisme discret.
Ensuite le lecteur suit les trajectoires de plusieurs personnages qui ne se contentent pas d’avancer en parallèle leurs intrigues spécifiques mais résonnent les unes avec les autres. Bon ils ne sont pas très complexes, pas très crédibles, mais Gemmel a du métier, il sait écrire et attirer l’intérêt (en tout cas après la première moitié du livre) du lecteur. Il manie bien la caméra, arrose comme il faut la scène, met de l’action et du mouvement et ça passe. En tout cas tant que les scènes s’enchainent, car quand le rythme baisse j’ai tout de suite décroché, il y manque vraiment un fond.
1. Acronyme bien connu de « Porte-Monstre-Trésor »